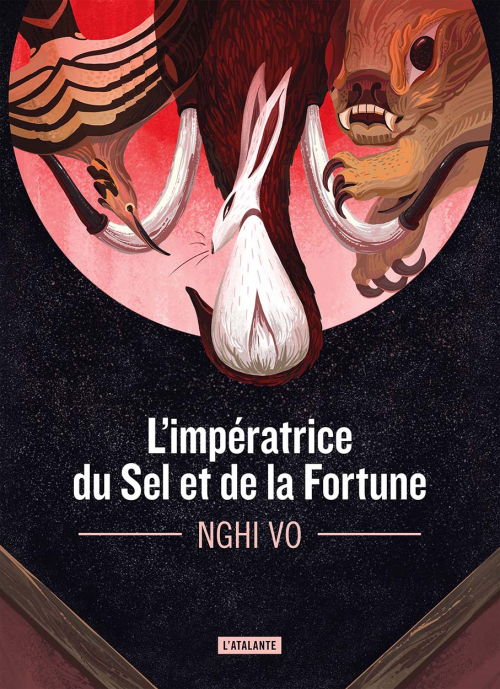On se retrouve aujourd’hui avec Toutes les nuances de la nuit, de Chris Whitaker, un roman noir paru aux éditions Sonatine en 2025. C’était ma première excursion dans l’univers de cet auteur britannique, et malgré quelques petites longueurs, j’ai beaucoup aimé ce roman.
Nous sommes à Monta Clare, une petite communauté tranquille du Missouri, en 1975. Patch Macauley, 13 ans, a disparu après avoir porté secours à une de ses camarades de classe aux prises avec un individu cagoulé. Borgne, Patch porte un bandeau de pirate, comme ceux qui peuplent son imaginaire. Saint est sa meilleure amie et décide de tout mettre en œuvre pour découvrir ce qui lui est arrivé. Lorsque Patch refait surface, presque un an plus tard, il évoque Grace, une adolescente à laquelle il doit d’avoir tenu le coup durant sa captivité, et qu’il n’aura de cesse, toute sa vie durant, d’essayer de retrouver.
Les personnages sont vraiment très attachants. Patch, ce jeune homme borgne qui se rêve en pirate, m'a profondément touchée. Élevé par une mère à la dérive, il n’a jamais eu la vie facile. Il vit sous le seuil de pauvreté, ne mange jamais à sa faim et s’accroche de toutes ses forces à sa seule amie : Saint. Élevée par sa grand-mère, cette dernière est tout sauf populaire, mais elle est dotée d’un caractère farouche, tenace et indépendant. Sa fidélité à son ami la poussera à veiller sur Patch à son propre détriment.
Chris Whitaker compose ici un casting mémorable, des personnages principaux jusqu'aux secondaires : Norma la formidable grand-mère, Misty l’adolescente sauvée par Patch, Nix l'inspecteur ou encore Sammy le directeur de la galerie d’art. Tous m’ont paru originaux et complexes, mais surtout terriblement humains, et crédibles dans cette Amérique de la fin du XXe siècle. On est à la limite de la littérature contemporaine avec ce roman. Saint et Patch recherchent un tueur en série, certes, mais réduire ce roman à cela serait une erreur. C'est aussi une fable profonde et complexe sur l'amour, le deuil, la résilience et l'espoir.
L'auteur explore l'amitié indéfectible, les traumatismes de l'enfance et leur impact sur l'âge adulte, mais aussi la quête identitaire et la possibilité de la rédemption. Le poids du regard social, la parentalité et ses ambiguïtés sont également au cœur de ce récit dense et humaniste. Whitaker parvient à aborder ces thématiques universelles avec une sensibilité rare, sans jamais tomber dans le pathos ou la facilité. La noirceur est là, bien sûr, entre enlèvements, deuils, familles déchirées, mais elle n'est jamais totale. Whitaker prend son temps, ce sont les personnages, leur évolution psychologique, leurs ressorts les plus intimes, qui propulsent l'action.
Alors oui, il y a quelques petites longueurs, et certains passages auraient pu être raccourcis sans nuire à l'ensemble. Mais ces moments plus lents ne gâchent en rien le plaisir de lecture, car ils servent souvent à approfondir la psychologie des personnages ou à installer une atmosphère. On sort de cette lecture bouleversé, pas par une révélation finale spectaculaire, mais par la somme des émotions traversées.
Jusqu'à ce jour de 1975, Monta Clare était une petite communauté tranquille des Ozarks. Aujourd'hui, les sirènes des voitures de police retentissent dans toute la ville. Dans un quartier paisible, les habitants sont interrogés, tous doivent fournir des alibis. La raison ? Le jeune Patch McCauley a disparu. Dans la forêt voisine, on a retrouvé son tee-shirt, maculé de sang. Saint, une jeune fille du village au caractère bien affirmé, décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour découvrir ce qui est arrivé à son ami. Elle harcèle le shérif, mène sa propre enquête, cherche des pistes. Les jours passent, puis les mois. L'affaire ne fait plus les gros titres des journaux, et cependant, Saint s'obstine. Trois cent sept jours plus tard, Patch McCauley réapparaît. L'affaire est réglée ? Non. Bien au contraire, il faudra des décennies pour élucider tous les mystères et faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé durant ces trois cent sept jours.
Le site de l'auteur : https://sites.prh.com/chriswhitaker