Qui ne connaît pas Frank Herbert ? Publié en 1982 aux États-Unis, La mort blanche est l'avant-dernier roman écrit par l'auteur de Dune. Quand on sait son immense talent pour créer des univers complexes tout en suscitant des interrogations profondes, on se dit qu'un roman explorant les conséquences d'une pandémie qui éradique les femmes doit être fascinant. Hélas, bien que très alléchant sur le papier, ce roman m’a bien déçue.
En plein centre de Dublin, John Roe O'Neill, un biologiste moléculaire, perd sous ses yeux sa femme et ses deux fils dans un attentat à la voiture piégée. Consumé par le chagrin et la soif de vengeance, il décide de fabriquer, dans un laboratoire de fortune, une arme bactériologique terrifiante, à laquelle on donnera le nom de peste blanche, qui tue les femmes, toutes les femmes, sans aucun remède connu. Un pitch glaçant, qui promet une réflexion sur le terrorisme, la vengeantce, mais aussi les bouleversements qu'entraînerait la disparition quasi totale des femmes.
Autant vous dire que j'en attendais beaucoup. Malheureusement, l’exploration de cette société, où les femmes deviennent à la fois une richesse nationale et du bétail, se résume aux derniers chapitres ! Herbert consacre l'essentiel de son récit à tout autre chose, et c'est très frustrant.
L'action se déroule principalement dans les plaines d'Irlande. Une grande partie du roman suit le périple de John O'Neill à travers le pays, accompagné de gens qui le surveillent sans être tout à fait sûrs de son identité, mais en s’en doutant fort. Ce voyage s'étire, s'allonge, se délaye dans des descriptions très semblables et des interactions redondantes qui n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. Le résumé était prometteur, mais à partir de ce voyage, c'est devenu d’un ennui mortel. On arrivait exactement au même point avec 200 pages de moins, si ce n’est plus !
Paradoxalement, on s’attache à John O'Neill malgré l'horreur de ses actes. Herbert parvient à créer un personnage profondément humain, un homme brisé par le chagrin qui commet l'irréparable. Et on ne peut s'empêcher de compatir, vu ce qui lui est arrivé. Cette ambivalence est, à mon sens, l'un des rares succès du roman. Les autres personnages, pourtant nombreux, ne bénéficient pas du même traitement, ils ne sont pas assez développés, juste des coquilles vides. L'équipe de scientifiques à la recherche d’un remède, par exemple, avait tout pour devenir un ancrage dans le roman, mais Herbert les met de côté après leur avoir pourtant consacré plusieurs chapitres.
Le style d'Herbert, si fluide dans Dune, semble ici moins inspiré. Le roman est complexe, notamment les parties scientifiques, alors quand en plus, des passages traînent en longueur sur des détails, ça devient lourd. Mais le comble de la frustration survient à la fin du roman, parce que l’auteur soulève enfin des questions intéressantes… dans les deux derniers chapitres ! On effleure à peine les conséquences de cette catastrophe. Herbert ne s'étend pas sur la transformation profonde d'un monde irrévocablement différent, où les femmes sont devenues si rares. Quel dommage !
J'ai dû me forcer à finir ce roman, alors que j'avais pourtant commencé avec beaucoup d'enthousiasme. Le talent de Frank Herbert transparaît par moments, notamment dans sa capacité à nous proposer un personnage complexe en la personne de John O'Neill, mais l'ensemble est une vraie déception, compte tenu du potentiel immense du sujet et de la réputation de l'auteur.
Lorque la voiture piégée explosa dans cette rue de Dublin, John Roe O'Neill perdit la raison : sous ses yeux, sa femme et leurs deux fils venaient de mourir par la faute d'un terroriste. John cessa d'exister ou plutôt il devint le Fou. Parce qu'il était biologiste moléculaire, sa folie était plus dangereuse qu'aucune bombe. Seul, dans un laboratoire de fortune, il fabriqua une arme bactériologique terrifiante, la peste blanche, qui tuait les femmes sans remède. Il allait faire partager sa souffrance par la Terre entière. Dans ce roman terrible et vraisemblable, Frank Herbert décrit un avenir proche : celui du terrorisme absolu.


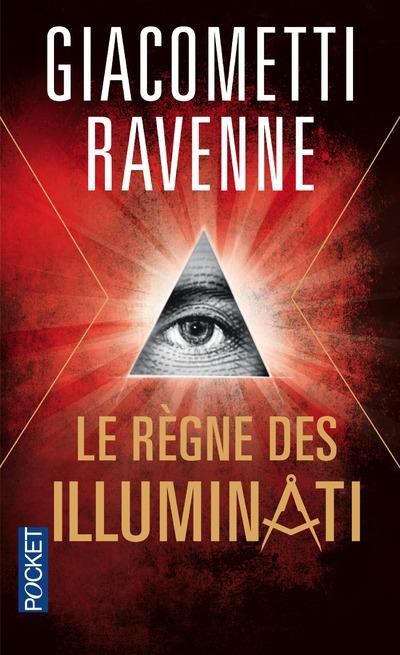






0 commentaires